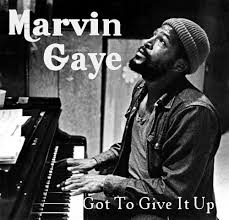L’exemple de GTA IV qui perd une partie de sa musique.
Alors que le jeu vidéo GTA IV fête les dix ans de sa sortie, son éditeur a décidé de supprimer, via une mise à jour, des dizaines de chansons dont les droits expiraient. En 2008, Grand Theft Auto IV s’est vendu à 3,6 millions d’exemplaires le jour de sa sortie. Dix ans après sa sortie, les droits sur une partie de sa bande originale ont expiré. Dans la dernière mise à jour du jeu, l’éditeur Rockstar Games a supprimé certaines chansons, en les remplaçant parfois par d’autres.
Mais certains se pose la question : si un jeu est une œuvre à part entière, peut-on l’amputer d’une partie de ce qui la constitue ?
Nous allons essayer de répondre à cette question en analysant le régime juridique du jeu vidéo.
Régime juridique du jeu vidéo.
Le jeu vidéo existe depuis maintenant presque un demi-siècle et si le droit français ne s’est pas désintéressé de la question de son régime juridique, notamment au regard du droit d’auteur, il semble qu’aucun régime juridique adapté n’a pour autant pu être dégagé.
A / Evolution jurisprudentielle du régime juridique du jeu vidéo.
Pour prétendre à la protection par le droit d’auteur, toute création doit répondre à deux critères principaux. Elle doit tout d’abord se manifester par une expression apparente et tangible et en second lieu être originale. Cette condition d’originalité n’est pas expressément mentionnée par le Code de la propriété intellectuelle comme condition de la protection, à la différence de nombreux droits étrangers qui la mentionnent expressément. Cette condition existait toutefois avant la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, de sorte que même après la promulgation de cette loi, il a toujours été considéré par la jurisprudence qu’à défaut d’être originale, une création ne pouvait prétendre à la protection offerte par le droit d’auteur (Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986).
La jurisprudence définit classiquement l’originalité comme le reflet ou l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur son œuvre. (CA Paris, 24 novembre 1988 et Cass. Civ. 1re, 17 février 2004.)
L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste des créations susceptibles d’être considérées comme une œuvre de l’esprit et donc pouvant être protégées par le droit d’auteur sous réserve d’être originales.
Le jeu vidéo ne figure pas dans cette liste. Toutefois, cette liste n’est pas limitative. La possibilité pour un jeu vidéo d’être protégé par le droit d’auteur n’a jamais été remise en cause. Cette possibilité a d’ailleurs été admise depuis longtemps par la Cour de cassation. (Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986, n° 84-93.509 « Atari Inc. c/ Valadom » et Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986, n° 85-91.465 « Williams Electronics Inc c/ Claudine T. et société Jeutel »).
Cependant, le régime de droit d’auteur applicable à une œuvre peut dépendre de la catégorie à laquelle elle est rattachée.
Ainsi, le régime juridique applicable à une œuvre audiovisuelle diffère de celui applicable à une œuvre logicielle.
Il faut donc savoir dans quelle catégorie d’œuvre le jeu vidéo doit être classé.
La difficulté du droit d’auteur à appréhender le jeu vidéo provient du fait qu’il s’agit d’une création protéiforme composée d’éléments logiciels, de bases de données mais également d’éléments visuels et audio.
La jurisprudence a donc connu de nombreuses hésitations quant au rattachement du jeu vidéo à une catégorie d’œuvre déterminée permettant ainsi de fixer le régime juridique devant lui être appliqué.
- Le jeu vidéo d’abord considéré comme une œuvre logicielle.
C’est tout d’abord la composante logicielle qui l’a emporté sur les autres. En 1997, la cour d’appel de Caen a ainsi considéré que « c’est le logiciel qui apparaît comme spécifique et primordial dans le produit complexe qu’est le jeu vidéo et celui-ci doit en conséquence bénéficier de la protection particulière accordée aux logiciels » (CA Caen, 19 décembre 1997 « Annie T. c/ Valérie A. »). La Cour de cassation suivra également cette analyse dans un arrêt du 21 juin 2000 (Cass. Crim, 21 juin 2000, n° 99-85.154).
L’œuvre logicielle répond à un régime particulier, notamment dans le cas d’œuvre logicielle réalisée par les salariés d’une société.
Selon l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
La jurisprudence en tire pour conséquence que la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre ne suffit pas à déroger à la règle voulant que ce soit l’auteur de l’œuvre qui jouisse des droits d’auteur relatifs à son œuvre (Cass. Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 91-11.480).
En matière de logiciel, cette règle connaît une dérogation majeure. Selon l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un logiciel est créé par un salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou suivant les instructions de son employeur, les droits d’auteur reviennent directement à l’employeur sauf stipulation contraire du contrat de travail.
La création d’un jeu vidéo nécessite l’intervention d’une multitude de personnes apportant chacune leur pierre à l’édifice en fonction de leurs compétences (développeurs, scénaristes, graphistes, etc.). Si ces différentes personnes sont des salariés du studio, la qualification du jeu vidéo en logiciel a pour conséquence directe de permettre au studio d’être propriétaire sans formalité particulière des droits d’auteur relatifs au jeu vidéo créé grâce à ces différents apports et créations.
Si, au contraire, le jeu vidéo n’est pas qualifié d’œuvre logicielle, le régime spécifique prévu par l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas et, en conséquence, le studio de développement doit contracter une cession de droit avec chaque personne ayant contribué au jeu et dont le travail est susceptible d’être qualifié d’œuvre.
- L’œuvre audiovisuelle écarté pour l’œuvre multimédia.
Si le jeu vidéo a une composante logicielle dont l’importance est indéniable, il diffère néanmoins des autres types de logiciels en ce que sa dimension audiovisuelle revêt une prépondérance au moins équivalente.
En effet, pour de très nombreux jeux vidéo, il apparaîtrait difficile de réduire la composante audiovisuelle au simple accessoire de la composante logicielle.
L’œuvre audiovisuelle se distingue des autres œuvres par son régime qui est spécifique. L’œuvre audiovisuelle est ainsi légalement présumée être une œuvre de collaboration, c’est-à-dire une œuvre à laquelle plusieurs auteurs ont concouru et qui en ont la propriété commune (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Concernant l’œuvre audiovisuelle, l’article L 113-7 du Code de la propriété intellectuelle fixe la liste présumée de ses auteurs et donc de ses propriétaires (le réalisateur, le scénariste, etc.).
Selon l’article L 112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre audiovisuelle se définit comme une œuvre consistant en des « séquences animées d’images, sonorisées ou non ».
Aucun des éléments de la définition donnée par l’article L 112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle n’est a priori incompatible avec le jeu vidéo. Cependant, la jurisprudence a toujours considéré que le caractère interactif d’une œuvre était incompatible avec la qualification d’œuvre audiovisuelle (CA Paris, 28 avril 2000 confirmé par Cass. Civ. 1re, 28 janvier 2003, n° 00-20.294).
Or, la principale différence entre un jeu vidéo et un film consiste bien en l’intervention du joueur qui n’est pas spectateur mais acteur de l’œuvre. De ce fait, la jurisprudence a eu tendance à qualifier les jeux vidéo d’œuvres multimédia.
Dans la célèbre affaire Cryo, la cour d’appel de Paris a ainsi considéré que le jeu vidéo ne relevait pas de la catégorie des œuvres audiovisuelles mais était une œuvre multimédia qui ne se réduit pas au logiciel qui permet son exécution (CA Paris, 3e chambre section B, 20 septembre 2007, RG n° 07/01793).
La qualification du jeu vidéo en œuvre multimédia n’a pas permis pour autant de sécuriser le régime juridique applicable au jeu vidéo.
D’une part, l’œuvre multimédia ne figure pas dans la liste de l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, la jurisprudence n’a jamais réellement esquissé les contours d’un régime juridique applicable à ce type d’œuvre.
Enfin, la jurisprudence a par la suite passablement complexifié la question en qualifiant le jeu vidéo d’œuvre complexe et en posant le principe d’un régime distributif (Cass. Civ. 1re, 25 juin 2009, n° 07-20.387).
B / La qualification retenue : l’œuvre distributive.
- L’adoption du régime d’œuvre distributive.
Lorsqu’une catégorie d’œuvre n’a pas de régime particulier, il convient de lui appliquer les règles de « droit commun » prévues par le Code de la propriété intellectuelle.
Concernant la question de la titularité des droits d’auteur d’une œuvre créée par plusieurs personnes, comme c’est souvent le cas en matière de jeux vidéo, le Code de la propriété intellectuelle distingue deux types d’œuvres : l’œuvre de collaboration et l’œuvre collective.
L’œuvre de collaboration, déjà évoquée ci-dessus, est la propriété commune des auteurs ayant concouru à sa création.
Une œuvre est qualifiée de collective lorsqu’elle est créée à l’initiative d’une personne, physique ou morale, et que sa création nécessite la contribution d’une pluralité d’auteurs, chacune des contributions se fondant « dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue » (article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle).
La création d’un jeu vidéo nécessite l’intervention d’une pluralité de compétences graphiques et techniques. Il était dès lors possible d’analyser ces différentes interventions en des contributions visant à se fondre dans l’ensemble que formera le jeu vidéo finalisé.
La qualification du jeu vidéo en œuvre collective semblait donc la plus vraisemblable et certainement la solution la plus simple. C’est d’ailleurs ainsi que de nombreux acteurs du domaine considéraient le jeu vidéo.
Pourtant dans un important arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation en a décidé autrement. Dans son arrêt Cryo, la Cour de cassation relève que le « jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci ». La Cour de cassation en conclut que chacune des composantes du jeu vidéo est soumise au régime de droit d’auteur qui lui est applicable selon sa nature.
La Cour de cassation a donc tranché en faveur d’un régime distributif, faisant ainsi cohabiter le régime de l’œuvre logicielle pour la composante logicielle du jeu, le régime de l’œuvre audiovisuelle pour les cinématiques, le régime de l’œuvre musicale pour la musique mais également, le cas échéant, le régime spécifique des bases de données ou encore le régime de droit commun pour toutes les composantes qui ne relèvent pas d’une catégorie d’œuvre dotée d’un régime spécifique.
Cette solution a été depuis reprise par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 septembre 2011 où elle énonce que « le jeu vidéo est une œuvre complexe dont chaque composant est soumis à un régime propre » (CA Paris, Pôle 5, Chambre 12, 26 septembre 2011, « Nintendo c/ Absolute Games »).
Pour les professionnels du secteur, cette solution aboutit finalement à complexifier encore plus la problématique relative au droit d’auteur applicable au jeu vidéo. Cette solution ne semble pas fonctionnelle, puisqu’elle revient à augmenter encore un peu plus l’insécurité juridique en la matière.
Cette acception peut sembler délicate à appréhender pour un secteur économique pesant plusieurs dizaines de milliards d’euros au niveau mondial, dont 2,6 milliards rien que pour le marché français.
- La spécificité de la musique.
Cette solution jurisprudentielle a mis en exergue la composante particulière qu’est la musique non spécialement composée pour le jeu vidéo, laquelle semble effectivement appeler à ce que son régime propre lui soit appliqué, comme c’est déjà le cas en matière d’œuvre audiovisuelle.
Dès 2007, toujours dans l’affaire Cryo, la cour d’appel de Paris avait pointé la particularité de la musique dans le jeu vidéo.
La cour d’appel avait alors relevé, à propos de compositions musicales appartenant à des auteurs adhérents de la SACEM et reproduites au sein d’un jeu vidéo, que celles-ci ne se fondaient pas dans l’ensemble que formait le jeu vidéo et qu’il était possible d’attribuer au compositeur ses droits distincts sur l’œuvre musicale.
Cette particularité des compositions musicales reproduites dans les jeux vidéo a également été relevée par les différents rapports rendus en la matière :
Ainsi, dans son rapport du 30 novembre 2011, le Député Patrice Martin-Lalande préconisait d’appliquer au jeu vidéo le régime de l’œuvre de collaboration avec une attribution de la qualité d’auteur basée sur les fonctions occupées lors du processus de création, notamment celle liée à la composition musicale spécialement réalisée pour le jeu.
Philippe Chantepie, dans son rapport du 27 février 2013, préconisait également que la composition musicale suive son régime propre et non celui proposé pour le jeu vidéo.
Il est vrai qu’à la différence des autres composantes du jeu vidéo, les musiques composant la bande originale peuvent être aisément différenciées du jeu en lui-même, et ce tout particulièrement lorsqu’elles n’ont pas été composées spécialement pour le jeu vidéo.
Les compositions musicales peuvent en outre faire l’objet d’une exploitation commerciale totalement séparée du jeu vidéo dans lequel elles ont été reproduites.
Il semble donc qu’il n’y ait pas d’obstacles à l’application du régime des œuvres musicales aux compositions musicales incorporées dans un jeu vidéo
Pour résumer :
Après des hésitations, la jurisprudence indique que le jeu vidéo est une œuvre complexe et retient la qualification d’œuvre distributive. La Cour de cassation en conclut que chacune des composantes du jeu vidéo est soumise au régime de droit d’auteur qui lui est applicable selon sa nature. La Cour de cassation a donc tranché en faveur d’un régime distributif, faisant ainsi cohabiter le régime de l’œuvre logicielle pour la composante logicielle du jeu, le régime de l’œuvre audiovisuelle pour les cinématiques, le régime de l’œuvre musicale pour la musique, mais également, le cas échéant, le régime spécifique des bases de données ou encore le régime de droit commun pour toutes les composantes qui ne relèvent pas d’une catégorie d’œuvre dotée d’un régime spécifique.
Le principal risque de cette qualification juridique réside dans la difficulté de retrouver les titulaires de droit de chaque composante du jeu vidéo. Cette qualification peut sembler difficile à appréhender pour les acteurs du monde du jeu vidéo et notamment les studios et les éditeurs pour l’exploitation de l’œuvre complexe.
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com